 Des visiteurs de la Cité interdite à Pékin, en Chine, cherchent l’ombre par une chaude journée d’été (juin 2024). Photo : Shutterstock
Des visiteurs de la Cité interdite à Pékin, en Chine, cherchent l’ombre par une chaude journée d’été (juin 2024). Photo : Shutterstock
À Paris, lors de la vague de chaleur du mois dernier, les autorités ont fermé plus d’un millier d’écoles, ainsi que le sommet de la tour Eiffel... Dans l’est de la Chine, des températures de 40,5 °C ont entraîné un pic de la demande de climatisation et mis à rude épreuve le réseau électrique. Au Royaume-Uni, selon les estimations de chercheurs en santé publique, la chaleur a tué 500 personnes en cinq jours seulement.
Nous ne sommes qu’au milieu du mois de juillet, mais, de Buenos Aires à Bangkok, citadins et autorités municipales subissent déjà des manifestations alarmantes qui rappellent l’urgence de s’adapter à un climat désormais rythmé par des étés bien plus chauds et périlleux.
La question de la chaleur urbaine préoccupe les maires des villes les plus riches du monde depuis des décennies. À Londres, où le scientifique Luke Howard a observé et décrit pour la première fois l’effet des îlots de chaleur urbains dans les années 1810, les pouvoirs publics déploient déjà toute une série de mesures : alertes sanitaires, programmes de sensibilisation des plus vulnérables, création d’un réseau d’espaces frais et obligation d’évaluer le risque de surchauffe pour tout nouveau bâtiment.
Si l’étude du climat urbain est une discipline ancienne, ses ensembles de données et outils de modélisation ont longtemps été façonnés par les budgets de recherche universitaire, donnant lieu à une abondance de travaux de qualité pour les villes des pays riches. Les études sont en revanche bien moins nombreuses pour celles des pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur, qui connaissent pourtant une intensification rapide des effets du changement climatique.
Pour la Banque mondiale, et plus particulièrement pour la Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement (GFDRR) (a) et son Programme pour la résilience des villes (a), il est essentiel de combler ce fossé en reliant les connaissances produites par la climatologie urbaine aux besoins urgents d’adaptation des villes des pays les moins riches. La semaine dernière, la 12ᵉ Conférence internationale sur le climat urbain (ICUC12) a ainsi été l’occasion d’organiser un hackathon invitant des chercheurs à concevoir des méthodes capables d’aider les villes à affronter la montée des risques liés à la chaleur.
De la recherche à la résilience : mieux exploiter les données
Lorsqu’on élabore un plan d’action contre la chaleur, les enjeux sont considérables et chaque détail compte. Prenons l’exemple du programme de recherche « Cooling Singapore ». Cette initiative financée par les pouvoirs publics s'est attachée à constituer une base de données sur les causes et les conséquences du stress thermique. Et ces connaissances ont permis d’orienter des politiques et des investissements qui ont conduit à la création de 370 kilomètres de corridors écologiques, au développement de 300 hectares d’espaces verts supplémentaires par des promoteurs immobiliers et à des innovations dans la construction, comme des peintures réflectives.
Mais la plupart des villes des pays à faible revenu ne possèdent pas les données détaillées et les équipements de surveillance dont dispose Singapour. L’amélioration des modèles pourrait-elle néanmoins leur fournir des réponses à des questions essentielles : quels quartiers ont besoin d’investissements pour limiter la chaleur, quelles adaptations des bâtiments permettraient d’éviter des températures intérieures dangereuses, et quelles populations alerter et sensibiliser avant une vague de chaleur ?
Ces questions étaient au cœur du hackathon sur la chaleur urbaine qui s’est tenu lors de l’ICUC et auquel ont participé 24 doctorants et enseignants-chercheurs venus de 19 pays.
 L’équipe gagnante du hackathon sur la chaleur urbaine et les membres du jury (de gauche à droite : Claire Gallacher, Flavia Ribeiro, Negin Nazarian, Ariane Middel, Tiago Silva, Felix Adebayo et Nicholas Jones).
L’équipe gagnante du hackathon sur la chaleur urbaine et les membres du jury (de gauche à droite : Claire Gallacher, Flavia Ribeiro, Negin Nazarian, Ariane Middel, Tiago Silva, Felix Adebayo et Nicholas Jones).
Le défi : exploiter des techniques scientifiques en rapide évolution pour modéliser les risques liés à la chaleur extrême dans les villes et les solutions pour y remédier, puis les traduire en actions concrètes (aménagements verts, lieux de fraîcheur, alertes de santé publique. etc.). Pour ce hackathon, les participants se sont concentrés sur deux villes au climat très différent : Tombouctou au Mali et Davao aux Philippines.
L’adaptation des villes à la chaleur extrême est complexe, en partie parce que les réponses les plus efficaces varient selon les types de climat (tempéré, aride ou tropical) et leurs particularités en termes de régimes saisonniers, de niveaux d’humidité et d’exposition des populations. Les décideurs publics ont besoin de données à plusieurs niveaux : à l’échelle de la ville, pour identifier les quartiers les plus exposés aux risques de « surchauffe » ; à l’échelle des quartiers, pour déterminer les interventions locales les plus pertinentes sur le plan des aménagements, de la végétalisation ou encore du choix de matériaux ; et à l’échelle des bâtiments, pour évaluer les risques de chaleur à l’intérieur des habitations et des écoles.
Les participants se sont attaqués à ces trois niveaux en utilisant les jeux de données et le code de départ (a) fournis par les organisateurs.
Les gagnants — Claire Gallacher (Royaume-Uni), Flavia Ribeiro (Brésil), Tiago Silva (Portugal) et Felix Adebayo (Nigéria) — ont appliqué une modélisation à l’échelle des quartiers pour recommander des investissements ciblés dans l’aménagement urbain et la santé publique. Le jury a salué leur approche pragmatique, fondée sur les données, et la clarté de leurs arguments en faveur de l’action.
 L’organisateur principal du hackathon Matthias Demuzere ouvre la session avec une présentation technique.
L’organisateur principal du hackathon Matthias Demuzere ouvre la session avec une présentation technique.
Des passerelles entre science et pratique pour des villes résilientes
Il y a seulement deux ou trois ans, un tel niveau de détail était hors de portée. Aujourd’hui, l’accès à des jeux de données mondiaux, à de nouvelles couches d’information et à des outils de modélisation avancés ouvre de nouvelles perspectives pour aider les villes à faire face à la chaleur extrême.
En plus de générer de nouvelles idées, ce hackathon a également mis en évidence des lacunes et des obstacles importants. Par exemple, les architectes utilisent souvent des outils de simulation pour évaluer les besoins énergétiques et les températures intérieures des bâtiments, mais les « fichiers météorologiques » sur lesquels reposent ces outils ne tiennent souvent pas compte de l’effet d’îlot de chaleur urbain. Intégrer dans ces outils les conditions climatiques futures et leurs effets en milieu urbain permettrait de concevoir des logements, écoles et lieux de travail mieux adaptés aux températures élevées des décennies à venir.
Alors que les villes cherchent à mettre en pratique les connaissances scientifiques, des initiatives comme le Programme pour la résilience des villes de la GFDRR — dont ont bénéficié 366 villes dans 94 pays et qui a contribué à guider plus de 8 milliards de dollars d’investissements de la Banque mondiale dans la résilience urbaine — sont en première ligne pour généraliser ces innovations. Mobiliser des données de pointe et l’expertise de chercheurs comme ceux réunis lors du hackathon, c’est apporter et accélérer des solutions pragmatiques contre la chaleur extrême dans un plus grand nombre de villes.
 Résultats de la modélisation de l’équipe gagnante.
Résultats de la modélisation de l’équipe gagnante.

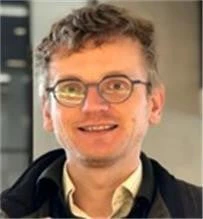

Prenez part au débat