 Un canal d'irrigation du Nil. Crédit photo : Shutterstock/Aleksandr Todorovic
Un canal d'irrigation du Nil. Crédit photo : Shutterstock/Aleksandr Todorovic
Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l'eau est synonyme de vie.
Pendant des siècles, la région était réputée pour sa capacité d'innovation en matière de préservation des ressources en eau et d'approvisionnement des populations. Il suffit de penser aux roues hydrauliques de Hama en Syrie, aux premiers barrages d'irrigation au Yémen, aux fontaines médiévales et aux puits urbains de Fès et de Marrakech au Maroc. Ces réalisations étaient des merveilles de technologie, très en avance sur leur temps.
Aujourd'hui, le tableau a radicalement changé. La région est confrontée à une situation d'urgence en matière d'eau qui s'aggrave lentement, certaines populations étant déjà gravement menacées. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) présente la plus faible disponibilité annuelle moyenne d'eau par personne, à savoir 480 mètres cubes en 2023, soit moins de 10 % de la moyenne mondiale et en deçà de la définition internationale de la pénurie d'eau. Alors que l'eau des rivières et des lacs se fait de plus en plus rare, les agriculteurs et d'autres acteurs font peser une charge insoutenable sur les eaux souterraines, ce qui accélère la crise. Près d'un quart de la population de la région vit aujourd'hui dans des zones où les eaux souterraines subissent un stress élevé voire extrême.
Cette pénurie s'aggravera dans les années à venir, avec l’augmentation de la demande en eau sous l'effet de la croissance démographique et économique, de l'urbanisation galopante et du changement climatique, qui affecte tout particulièrement les ressources hydriques, notamment en raison de l'évaporation et de la demande de refroidissement.
La bonne nouvelle, c'est que de nombreux pays de la région MENA prennent déjà des mesures pour préserver cette ressource très précieuse, et que d'autres commencent à faire de même. Il existe aujourd'hui de nombreuses opportunités qui ouvriront la voie à un avenir plus sûr en matière d'eau pour l'ensemble de la région. Les stratégies fructueuses adoptées par certains pays indiquent clairement la voie à suivre.
Tout d’abord, il faut faire en sorte que la région MENA redevienne un leader technologique et investir dans l’innovation. La région devrait adopter les nouvelles technologies numériques qui contribuent à améliorer la gestion de l'eau, à raccorder la population à des services d'eau améliorés et à accélérer la croissance économique. Du côté de l'offre, le dessalement et la réutilisation des eaux usées traitées apparaissent comme des solutions essentielles pour stimuler l'offre. La région MENA concentre aujourd'hui plus de 53 % de la capacité mondiale de dessalement. Même si le coût de ces technologies a considérablement reculé du fait de l'innovation, il faudra poursuivre les efforts si l’on veut que le coût relativement élevé de l'eau dessalée ne pèse pas sur les plus déet les pays les plus pauvres. Parallèlement, la région devra impérativement utiliser l’eau de manière nettement plus efficace et réduire les pertes.
La région doit également donner de toute urgence la priorité aux pratiques intelligentes sur le plan climatique en matière de gestion de l’eau. Il s'agit notamment de renforcer les capacités de collecte de données climatiques et hydrologiques précises, qui permettront aux systèmes de s'adapter aux modifications des régimes de précipitations et à la fréquence accrue des sécheresses et des inondations. Ces informations permettront d’éclairer la prise de décision sur la manière d'allouer les ressources en eau et de se préparer aux situations d'urgence, comme les sécheresses et les inondations.
Les pays peuvent également orienter la politique de l'eau de manière à stimuler les secteurs créateurs d’emplois. Il s'agit notamment d'une agriculture intelligente sur le plan climatique et économe en eau pour les exportations, ainsi que des solutions innovantes concernant le lien entre l'énergie et l'eau, comme le stockage d'hydroélectricité par pompage et le recours aux énergies renouvelables dans les services liés à l'eau. Donner la priorité à ces secteurs peut contribuer à faire évoluer la gestion de l'eau dans le bon sens, mais aussi à créer des emplois indispensables et à améliorer les compétences.
Pour de nombreux pays, ce changement va nécessiter une réforme en profondeur du secteur de l’eau. Une grande partie de l'infrastructure de la région est fragile, tout comme les institutions qui la soutiennent. Dans certains systèmes de distribution d'eau, les pertes peuvent atteindre 50 % ; la réduction des pertes est donc la première des priorités pour les pays concernés. En outre, la région affiche des frais de service pour l'eau parmi les plus bas du monde et la plus forte proportion du produit intérieur brut consacrée aux subventions publiques pour l'eau (2 %). Les pays devront passer à une tarification plus durable qui décourage le gaspillage tout en protégeant les personnes pauvres et vulnérables. Dans le même temps, des incitations et des innovations seront nécessaires pour accroître la participation du secteur privé à la restauration et au développement des infrastructures, y compris au moyen de garanties.
Enfin, le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de ressources hydriques pourrait avoir des retombées immenses dans l’ensemble de la région MENA. En effet, deux ou plusieurs pays se partagent plus de 60 % des ressources en eau de la région, ce qui présente des opportunités considérables en matière de collaboration et de partenariat pour une meilleure gestion de ces ressources vitales. La première étape consiste à discuter et à mettre en commun les connaissances, comme la région l'a souvent déjà fait par le passé.
C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir les pays se réunir au Koweït cette semaine à l’occasion du premier forum régional sur l'eau, organisé conjointement par le Fonds arabe pour le développement économique et social et la Banque mondiale. Ce forum est une excellente occasion de relever les grands défis de la région dans le domaine de l'eau, notamment grâce à un financement stratégique du développement et à des partenariats public-privé. Il témoigne également de l'approfondissement du partenariat stratégique entre nos institutions, qui reconnaissent qu'un effort de collaboration est essentiel pour y parvenir, et que la mobilisation de toutes les parties prenantes est indispensable si l'on veut obtenir des résultats à grande échelle.
Le Fonds arabe s'appuie sur plus d'un demi-siècle d’expérience de terrain et sur sa capacité financière pour lutter contre la pénurie d'eau dans la région. Il a fourni plus de 8,1 milliards de dollars pour financer 149 projets liés à l'eau. Ces projets ont bénéficié à des millions de personnes et ont aidé les pays arabes à créer plus de 3 800 kilomètres de réseaux d'assainissement. Ces réseaux traitent chaque jour 6 millions de mètres cubes d'eaux usées, ce qui est essentiel pour renforcer la sécurité alimentaire et protéger la population et l'environnement contre les maladies.
La Banque mondiale s'engage activement à aider les pays de la région à jeter les bases d'un avenir plus résilient à l'égard de l'eau. Au Maroc, un projet d'approvisionnement en eau en milieu rural soutenu par la Banque mondiale a permis de raccorder plus de 1,1 million de personnes à un réseau d'eau potable. En Égypte, une approche innovante de l'assainissement rural a permis à des milliers de ménages de participer à la planification et à la mise en œuvre de projets. Enfin, en Jordanie, un effort sectoriel permet de réduire systématiquement les pertes et de fournir suffisamment d'eau à la population dans l'une des régions du monde les plus touchées par le stress hydrique.
Nous sommes convaincus que ces efforts et ces solutions porteront leurs fruits. Et nous sommes convaincus qu'en collaborant, nous pouvons faire en sorte que l'eau soit préservée et utilisée judicieusement pour la prospérité et le développement durable des générations futures - dans une région où chaque goutte d'eau compte.

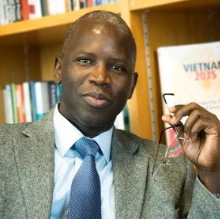

Prenez part au débat