 Malgré les programmes de soutien, de nombreux petits entrepreneurs continuent de connaître de faibles niveaux de productivité, de profits et de revenus. Copyright : Arne Hoel/Banque mondiale
Malgré les programmes de soutien, de nombreux petits entrepreneurs continuent de connaître de faibles niveaux de productivité, de profits et de revenus. Copyright : Arne Hoel/Banque mondiale
Les travailleurs indépendants représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre mondiale. Conscients de la nécessité de soutenir les microentrepreneurs, les pouvoirs publics et les institutions de développement consacrent plus d’un milliard de dollars par an à leur formation (a).
Pourtant, malgré l’ampleur de ces dépenses, de nombreux petits entrepreneurs continuent de connaître de faibles niveaux de productivité, de profits et de revenus.
Ces difficultés tenaces soulèvent un certain nombre de questions : quels sont les types de programmes les plus aptes à soutenir l'entrepreneuriat ? Comment venir en aide à tous les microentrepreneurs, y compris les femmes et les entrepreneurs « de subsistance » ? Et comment leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour diriger une entreprise prospère et exploiter de nouveaux marchés ou des secteurs à haut rendement ?
La Banque mondiale et l’initiative Emplois et opportunités (JOI) du J-PAL (a) contribuent à répondre à ces questions en appuyant des études à la pointe de la recherche sur l’entrepreneuriat et la création d’emplois. Voici un tour d’horizon des enseignements tirés de nos travaux de recherche et d’un nombre croissant de données sur les interventions visant à soutenir les microentrepreneurs dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Les programmes qui facilitent l’accès des entrepreneurs aux marchés, aux financements ou à des formations commerciales donnent des résultats mitigés
Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés peut effectivement améliorer leurs résultats. Ce soutien consiste par exemple à renforcer la capacité des entreprises à vendre leurs produits sur des marchés étrangers ou à des multinationales, à développer les infrastructures physiques et numériques, et à éliminer les obstacles à l’information. Cependant, si ces interventions peuvent être pertinentes pour les grandes entreprises, il existe peu de données probantes concernant les effets de l’accès aux marchés sur la croissance des microentreprises.
Dans le même temps, une série d’évaluations randomisées montre que les subventions, les microcrédits et les programmes de formation commerciale peuvent avoir une incidence positive sur les résultats des entreprises (en termes de bénéfices et de croissance, notamment), sans mettre toutefois en évidence d’effets systématiquement transformateurs (a).
Les disparités d’impact pourraient s’expliquer par les différences de conception et de mise en œuvre des interventions
Si la microfinance traditionnelle a eu un impact limité sur la croissance des entreprises, on observe des approches plus prometteuses, comme le fait de faire évoluer les produits financiers (a), en offrant par exemple aux emprunteurs une plus grande flexibilité et des délais de grâce pour le remboursement de leurs prêts, ou encore de tirer parti des possibilités de microfinancement garanti par des actifs (a). Il ressort également de ces études que les programmes de formation centrés sur le « savoir-être professionnel » ont un plus grand impact que les formations entrepreneuriales classiques (a) généralement axées sur le « savoir-faire ».
Les capacités propres des individus peut également influer sur les résultats de leur entreprise. Par exemple, une étude du J-PAL menée à Hyderabad (Inde) a révélé que seuls les entrepreneurs ayant une expérience préalable de la gestion d’une entreprise réalisaient des bénéfices plus élevés (a) après avoir eu accès à des microfinancements. Comme le suggèrent par ailleurs diverses évaluations randomisées (a), il semble prometteur de cibler ce sous-ensemble d’entrepreneurs ayant un plus grand potentiel de croissance afin d’accroître l’impact des programmes de soutien à l’entrepreneuriat.
Faut-il plutôt allouer des ressources à des entrepreneurs à fort potentiel ou promouvoir l’inclusion ?
Les décideurs politiques font face à un arbitrage difficile. D’un côté, ils peuvent choisir d’allouer leurs ressources en soutien à des entrepreneurs à fort potentiel, mais cette approche risque de laisser pour compte ou pénaliser les entrepreneurs de subsistance. De l’autre, ils peuvent donner la priorité à l’inclusion en élargissant leur soutien à tous les types d’entrepreneurs. Cette approche plus inclusive risque toutefois de conduire à une allocation inefficace des ressources et de freiner des entreprises qui pourraient produire un impact important. Pour résoudre ce dilemme, les responsables publics devront choisir une approche qui réponde à leurs objectifs ou utiliser plusieurs instruments pour des buts distincts.
Les décideurs publics doivent tenir compte du contexte et de la mise en œuvre des programmes d’aide aux entrepreneurs
Les résultats d’une évaluation randomisée ne peuvent pas servir de modèle général à la mise en place de programmes dans différents contextes culturels ou sociaux. Pour optimiser l’efficacité des programmes d’appui à l’entrepreneuriat, il est indispensable de tenir compte des aspects propres à chaque contexte. Par exemple, dans certaines régions, les normes culturelles et sociales peuvent réduire l’efficacité des subventions en espèces ou des microfinancements pour les femmes entrepreneures car ces dernières risquent de devoir partager leurs fonds avec d’autres membres du ménage (a). Pour y remédier, des versements électroniques sur des comptes détenus par ces femmes pourraient garantir que les ressources sont effectivement dirigées vers leurs entreprises (a). Par ailleurs, la qualité des partenaires d’exécution ou des formateurs (a) peut faire une réelle différence sur l’impact d’un programme.
Pistes de recherche sur les programmes d’aide à l’entrepreneuriat
Plusieurs aspects doivent encore être mieux compris : comment identifier au mieux les entrepreneurs à fort potentiel, de manière prévisible et transposable à plus grande échelle ? Comment les microfinancements et les programmes de formation commerciale pourraient-ils mieux répondre aux besoins des microentrepreneurs ? Quels autres programmes de formation sont plus efficaces pour améliorer les performances des entrepreneurs, et pourquoi ? Quels sont les principaux obstacles au niveau local qui entravent la demande et la croissance des microentrepreneurs ?
Ces questions sont au cœur de nos travaux de recherche pour aider les décideurs politiques à mieux soutenir les microentrepreneurs. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le portail Emploi et développement de la Banque mondiale (a) et l’initiative JOI du J-PAL (a).
Ce billet s’inspire du numéro de février 2024 de la newsletter Knowledge4Jobs, publiée conjointement par le groupe Emplois et la cellule Solutions mondiales pour la main-d’œuvre et les compétences de la Banque mondiale. Cliquez ici pour vous abonner !

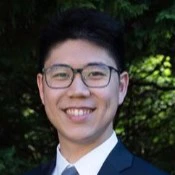

Prenez part au débat