
Face au nombre d’interprétations biaisées et inexactes de la manière dont le Groupe de la Banque mondiale mesure le développement intelligent et ses liens avec le changement climatique — notamment un tout récent billet de blog du Center for Global Development (CGD) —, nous souhaitons ici rétablir la vérité.
Le développement est au cœur même de la vision du Groupe de la Banque mondiale : mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable. Aujourd’hui, 44 % de la population mondiale est pauvre, et près de 700 millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté avec moins de 3 dollars par jour, que ce soit dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Nous utilisons nos connaissances et nos financements pour créer des emplois — la meilleure façon de porter un coup fatal au fléau de la pauvreté — et pour investir dans les infrastructures sous-jacentes nécessaires pour soutenir ces emplois : l’énergie, l’eau, l’éducation et la santé, pour n’en citer que quelques-unes. Parallèlement, de nombreux pays s’efforcent de développer leur économie et de sortir leur population de la pauvreté alors qu’ils sont en butte à l’augmentation des températures et du niveau des mers, à des inondations et des sécheresses plus fréquentes et à des tempêtes de plus en plus violentes. C’est pourquoi nous devons prendre en compte les réalités individuelles des pays, répondre à leurs demandes et veiller à ce que le financement que nous fournissons soit destiné à un développement intelligent.
Selon une méthodologie que nous partageons avec neuf autres banques multilatérales de développement et qui a été appliquée à partir de 2011, nous considérons que nos projets de développement procurent des « co-bénéfices » climatiques lorsqu’ils contribuent aussi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou de la vulnérabilité aux effets des dérèglements du climat. Ce sont avant tout des projets de développement, et leur évaluation doit donc démontrer qu’ils apportent des avantages significatifs en termes de développement.
C’est pourquoi les récentes critiques formulées dans le billet du CGD sont infondées. Elles ne tiennent pas compte du fait que nous ne finançons pas des projets justifiés uniquement par leur impact sur le plan de la lutte mondiale contre le changement climatique : nos projets doivent être justifiés par les besoins de développement considérés comme prioritaires au niveau local. Tenir compte des co-bénéfices climatiques, c’est agir pour un développement intelligent, de grande qualité et budgétairement responsable, ce qui implique d’intégrer la résilience dans tout ce que nous faisons. C’est ce que veulent nos clients et c’est ce sur quoi nous nous concentrons.
Le billet du CGD pose quelques questions, dont celles-ci :
Sur l’atténuation : pourquoi soutenons-nous des mesures d’atténuation dans les pays les plus pauvres qui contribuent le moins aux émissions mondiales ? Parce que nous finançons des projets de développement à fort impact qui présentent en outre l’avantage de réduire les émissions. Prenons par exemple le réseau de transport par bus rapides que nous avons financé à Dakar en apportant 100 millions de dollars de financement concessionnel : ce projet contribue à créer un système de transport urbain moderne et efficace et à rapprocher les personnes des emplois, tout en réduisant les émissions. On peut également citer un projet destiné à aider les riziculteurs à adopter des pratiques plus efficaces (a) : au cours des sept années écoulées depuis le lancement du projet en 2015, les riziculteurs du delta du Mékong ont augmenté leurs revenus de 30 % en moyenne et ont aussi réduit les émissions de méthane provenant de leurs champs.
Un autre exemple ? Une initiative visant à promouvoir la cuisson propre comme le projet d’extension de l’accès à l’électricité (a) en Ouganda, qui fournira 353 000 solutions de cuisson propre à 1,6 million de personnes. Cet investissement a pour but de sauver des vies, en particulier celles des femmes et des enfants, menacées par la pollution de l’air intérieur qui tue chaque année près de 700 000 personnes en Afrique subsaharienne.
Il ne s’agit pas de projets climatiques. Ce sont des projets de développement qui ont un impact positif sur l’emploi et les populations et qui s’appuient sur des technologies à faible taux d’émission, offrant ainsi des co-bénéfices en matière d’atténuation du changement climatique. Nous sélectionnons des investissements qui améliorent la vie des pauvres dans tous les pays où nous travaillons, en recourant aux meilleures technologies disponibles et en contribuant ainsi pas à pas à rendre la planète plus vivable. Par ailleurs, selon la propre analyse du CGD, nous dépensons presque neuf fois plus pour l’atténuation dans les pays à revenu intermédiaire et élevé que dans les pays à faible revenu (environ 32 milliards contre 3,6 milliards de dollars). Il est donc fallacieux de prétendre que nous privilégions l’atténuation dans les pays à faible revenu. Ce n’est tout simplement pas vrai.
Sur l’adaptation : pourquoi les fonds alloués à l’adaptation ne sont-ils pas tous destinés aux pays les plus pauvres ? Les investissements dans l’adaptation relèvent tout simplement d’un développement intelligent. Il s’agit de rendre les personnes, leurs biens, leurs emplois et leurs infrastructures moins vulnérables et plus résilients. En tant que tels, ils procurent davantage de bénéfices par dollar investi, ce qui est une caractéristique essentielle de la bonne gestion des ressources publiques. Pourquoi investir dans des routes qui seraient emportées par la prochaine inondation si elles peuvent être conçues pour y résister ? Pourquoi ne pas investir dans les mangroves pour protéger le littoral et améliorer la pêche côtière ? Que ce soit dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, intégrer la résilience dans nos projets et renforcer la résilience et ouvrir des perspectives grâce à nos projets, c’est œuvrer pour un développement intelligent et maximiser le rendement de ressources financières limitées.
À une époque où les ressources internationales, publiques et privées, sont fortement sollicitées pour couvrir une multitude de besoins, nous croyons encore plus fermement à la nécessité de transparence sur la destination de l’argent que nous investissons. Et aussi à la précision des informations sur ces investissements. C’est pourquoi nous sommes extrêmement surpris par la présentation erronée dans le billet du CGD de ce que nous faisons, des endroits où nous le faisons et de l’ampleur de ce que nous faisons. Nous ne comprenons pas comment le CGD a constitué son échantillon, qui diffère considérablement de nos données. Leur échantillon comprend 925 projets, dont 825 désignés comme climatiques. Or, durant les exercices 2023 et 2024, seuls 676 projets BIRD/IDA ont été approuvés par notre Conseil des administrateurs, dont 96 % présentaient des co-bénéfices climatiques. En outre, le billet fait référence à une analyse antérieure qui porte sur nos projets depuis 2000, alors que nous ne suivons et ne publions les co-bénéfices climatiques que depuis 2011.
Contrairement à ce qu’affirme le CGD, seul un cinquième de notre financement climatique correspond à de « petites interventions », définies comme celles dont le budget est inférieur à 10 % de l’allocation du financement climatique. Et lorsque c’est le cas, c’est sur la base d’une analyse rigoureuse du contenu du projet : dans un projet d’éducation au Guyana, par exemple, la résilience climatique a été prise en compte dans la conception des bâtiments, de manière à protéger les élèves de la chaleur excessive ou des conséquences des inondations. Il aurait été évidemment irresponsable de les construire autrement. Donc, non seulement le CGD se trompe sur la définition même du financement climatique, mais la méthodologie qui sous-tend son analyse présente elle aussi des imperfections flagrantes.
Nous sommes à un point d’inflexion pour le développement. Nous sommes face aux défis bien connus que sont la pauvreté, la fragilité, les conflits, l’augmentation de la dette, mais aussi, de plus en plus, à la nécessité d’améliorer la résilience et de tirer parti des possibilités offertes par des technologies plus vertes et plus efficaces. Les co-bénéfices climatiques évaluent la mesure dans laquelle nous saisissons ces occasions favorables pour apporter davantage aux populations des pays à revenu faible et intermédiaire. Nous améliorons sans cesse nos méthodologies et nos indicateurs afin de mieux mesurer notre impact sur la vie des populations et notre nouvelle Fiche de performance (a) est un pas important dans cette direction. La prise en compte du changement climatique et des technologies climatiques est une caractéristique de notre engagement en faveur d’un développement économiquement efficace et centré sur l’obtention de résultats.

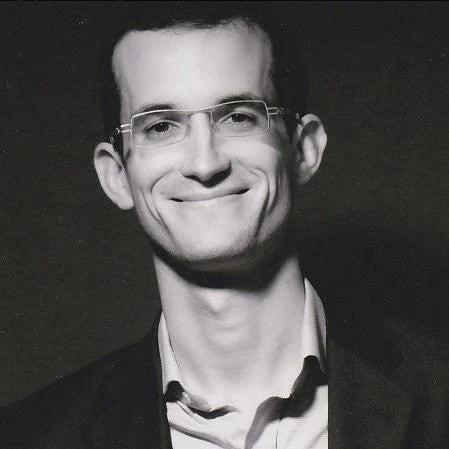


Prenez part au débat