 Two people conducting a transaction via mobile and digital app.
Two people conducting a transaction via mobile and digital app.
Les investissements consentis dans la transformation numérique de l’administration publique rendent celle-ci plus efficace, mais aussi plus apte à anticiper et faire face aux situations d’urgence, qu’elles soient d’ordre sanitaire, climatique, sécuritaire ou commercial. La pandémie de COVID‑19 en a fourni une démonstration éclatante. C’est ce que souligne le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’indice de maturité GovTech (a). Ce rapport dresse un état des lieux des progrès dans le monde en matière de transformation numérique du secteur public, en mettant en évidence l’importance cruciale des solutions de GovTech en temps de crise.
Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), les investissements réalisés par les pouvoirs publics dans les infrastructures, les plateformes et l’armature numériques avant le début de la pandémie les ont aidés à mener rapidement des interventions essentielles face à la crise de la COVID, à assurer la continuité des services fournis à la population et à soutenir les personnes et les entreprises les plus vulnérables.
Les exemples qui en attestent ne manquent pas. En Jordanie, dans le cadre d’un projet de la Banque mondiale qui s’est achevé en 2019 (a), le gouvernement avait mis sur pied une base de données pour mieux cibler les transferts monétaires en faveur des ménages pauvres. La création de cette base de données unifiée a consisté à relier les systèmes d’information de gestion de six organismes gouvernementaux et plus d’une vingtaine de bases de données différentes. Elle a nécessité l’élaboration d’un cadre d’interopérabilité des données et la mise en place de dispositifs institutionnels porteurs. Et parce qu’elle était déjà opérationnelle au début de la pandémie, elle a permis aux autorités d’identifier immédiatement les ménages pouvant bénéficier d’allocations monétaires d’urgence. Le Fonds d’aide national a ainsi effectué plus de 380 000 versements (a) au cours des quatre premiers mois de la pandémie. En outre, la proportion de bénéficiaires utilisant des portefeuilles électroniques mobiles a bondi de 6 à 69 %.
À Djibouti, le gouvernement avait déjà engagé la dématérialisation des procédures douanières avant 2020, avec un impact flagrant sur la proportion de déclarations effectuées par voie électronique, qui a grimpé de 64 à 93 % entre 2019 et 2021. Grâce à cet investissement et à la transition digitale en cours, les pouvoirs publics ont pu limiter plus facilement les contacts interpersonnels pendant la pandémie.
Ces deux exemples illustrent toute l'utilité de la numérisation de l’administration publique, en particulier à l'orée d’une crise comme celle de la COVID. Alors que les États de la région MENA s’efforcent de mener à bien leur transformation numérique et de renforcer leur résilience, voici cinq aspects essentiels à prendre en compte pour y parvenir :
- Il est indispensable de poursuivre les investissements dans l’accès à internet pour tous. Augmenter les investissements dans les infrastructures numériques qui garantissent un accès équitable à l’internet doit continuer d’être une priorité.
- L’écosystème de la GovTech doit être renforcé. De nombreux pays ont investi massivement dans l’infrastructure « immatérielle » sur laquelle repose la transformation numérique. On entend par là l’ensemble des facteurs intangibles qui rendent possible une action coordonnée : législation, institutions, compétences, etc. Mais il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la mise en œuvre des politiques et réglementations, ainsi qu’en matière de renforcement des capacités institutionnelles.
- La confidentialité des données doit être garantie et respectée efficacement. Pour réussir la transformation numérique, il faut garantir l’accès à l’information, tout en assurant la protection des données personnelles. Au début de la pandémie, face à l’urgence sanitaire, les préoccupations entourant la collecte et la protection des données personnelles sont parfois passées au second plan par rapport à la nécessité d’agir rapidement. Comme le montre le dernier indice de maturité GovTech, une majorité de pays disposent désormais de lois et d’organismes encadrant la protection des données. Les progrès sont en revanche encore insuffisants en ce qui concerne l’application des règles et les performances des autorités concernées.
- Les pays doivent se doter de mécanismes efficaces de collaboration intersectorielle et de coordination de l’action publique. L’utilisation de données et d’outils numériques en vue de guider les mesures à prendre et d’assurer la continuité des services en cas de crise nécessite une action coordonnée mobilisant les ministères compétents, les organismes techniques et les responsables politiques, mais aussi le secteur privé, les médias et la société civile. Les cadres d’interopérabilité des données permettent un partage efficace de l’information entre ministères, tandis que la mise en place de groupes de travail réunissant diverses parties prenantes peut favoriser des réponses plus rapides et adaptées à l’évolution de la situation sur le terrain.
- Le secteur privé peut jouer un rôle clé dans la transformation numérique du secteur public. L’expérience de la COVID a mis en lumière l’efficacité d’un modèle public-privé qui repose, d’une part, sur un leadership public autour d’un problème clairement identifié et, d’autre part, sur la fourniture d’une plateforme de collaboration entre parties prenantes permettant un déploiement relativement rapide de solutions pratiques.
Comme on l’a vu pendant la pandémie, investir dans la transformation numérique du secteur public est capital pour assurer une gouvernance efficace, s’adapter à une « nouvelle normalité » et se préparer aux crises à venir. Dans le même temps, il faut atténuer les risques engendrés par le recours croissant aux processus digitaux, qui crée de nouvelles vulnérabilités et menaces (pannes de réseau, cyberattaques, etc.).
Le renforcement progressif des capacités numériques du secteur public pourrait même contribuer non pas à réduire des problèmes chroniques de gouvernance, mais au contraire à les amplifier. Si les gouvernements de la région MENA veulent exploiter tout le potentiel du numérique pour reconstruire et renforcer le contrat social, ils devront s’attacher en priorité à se doter d’un cadre politique, juridique et réglementaire solide pour protéger les droits individuels et à faire leurs les principes de transparence, d’inclusion, de participation citoyenne et de responsabilité qui régissent la GovTech.

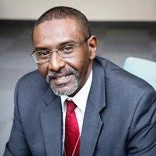



Prenez part au débat